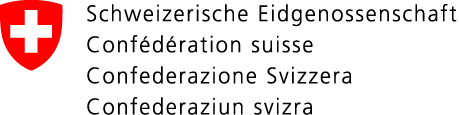La Première Guerre mondiale bouleverse la Suisse, tant dans son approvisionnement que dans la gestion de sa main d’œuvre. Par leur investissement durant le conflit, les femmes vont jouer un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du pays, ce qui servira de base à leurs revendications et à la mise en valeur de leurs implications dans l’économie.
La mobilisation générale de 1914 redistribue les rôles dans les différents secteurs d’activités. En l’absence de leurs maris et de leurs fils, les femmes se voient obligées de remplacer les hommes là où les besoins se font sentir. Cette féminisation de l’emploi est d’autant plus vitale que la solde des appelés et leurs rares indemnités sont insuffisantes à faire vivre correctement les ménages.
Un engagement pas si nouveau que ça
La présence féminine dans ce contexte économique tendu varie selon les secteurs. Si l’agriculteur envoyé au front peut compter sur son épouse ou ses parents pour assurer l’exploitation du domaine, il en va autrement dans le salariat. Dans le secteur secondaire, en particulier dans l’industrie horlogère, les femmes font déjà partie intégrante des fabriques et représentent environ un tiers des effectifs entre le début du siècle et 1910. Un chiffre qui augmentera à près de 40% durant l’entre-deux-guerres.

Les deux SAFFA
SAFFA est l’acronyme en allemand de « Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit » (exposition suisse du travail des femmes). On désigne par ce sigle deux expositions (1928 à Berne et 1958 à Zürich) qui furent organisées par des associations féministes. La première met en évidence la femme et ses difficiles conditions de travail dans la Suisse d’après-guerre tout en présentant les atouts du travail féminin pour l’économie. L’émancipation, en matière de droit de vote, y est déjà plébiscitée. La seconde exposition se concentre sur les possibilités pour les femmes d’exercer un métier, de se former et sur la consommation en général. En outre, les contributions des femmes sont présentées comme essentielles au bon fonctionnement de la nation.
Trois activistes clés
Margarethe Hardegger, Dora Staudinger et Else Züblin-Spiller ont œuvré chacune à leur manière à la reconnaissance des droits des femmes durant cette période.
Margarethe Hardegger a milité toute sa vie pour les droits de la femme. Elle fonde son premier syndicat en 1904 et devient deux ans plus tard la première secrétaire de l’Union syndicale suisse (USS). Elle se bat contre les inégalités sociales et l’exploitation au travail, dont les victimes sont principalement les femmes ouvrières. Ses idées sont loin d’être conventionnelles pour l’époque : elle défend la liberté sexuelle, le droit à la contraception et à l’avortement. Pacifiste, elle préconise également la suppression de l’armée. Elle est aussi l’initiatrice de communautés agricoles et s’engage dans la lutte pour le droit de vote des femmes.
D’abord journaliste politique, Else Züblin-Spiller s’investit par la suite dans la lutte contre la pauvreté. En 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Else Züblin fonde l’Association pour le bien des soldats qui, au sein de foyers ad hoc, proposent des repas équilibrés, à bas prix et sans alcool. Sur le même modèle, elle met sur pied des cantines dans les usines. En 1916, elle établit le service d’aide du soldat. Elle s’investit également dans le mouvement des femmes en les encourageant à travailler et prend part à la SAFFA.
Dora Staudinger est une militante allemande qui s’est installée à Zurich en 1912. Elle est l’une des rares femmes en Suisse à avoir joué un rôle important dans le mouvement de réforme du logement, notamment au sein de la coopérative Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ), fondée en 1916. En 1913, elle fonde la première coopération de femmes dans la Lebensmittelverein Zürich (Société coopérative de Zurich). Elle devient membre du parti socialiste dès 1914 et crée avec Clara Ragaz en 1915 la branche suisse de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Elle se bat également pour que les besoins des femmes au foyer soient pris en considération.
Bibliographie et sources
- De Weck, Hervé; Roten Bernard. Jura et Jura bernois pendant la Première Guerre mondiale. Porrentruy: Editions D+P ; Société jurassienne des officiers, 2017.
- Lachat, Stéphanie. Les pionnières du temps : vies professionnelles et vies familiales des ouvrières de l’industrie horlogère suisse (1870–1970). Neuchâtel: Edtions Alphil-Presses universitaires suisses, 2014.
- Voegeli, Yvonne. Saffa. In : Dictionnaire historique de la Suisse [en ligne]. Version du 07.06.2016.
Sur Margarethe Hardegger
- Bochsler, Regula. Ich folgte meinem Stern: das kämpferische Leben der Margarethe Hardegger. Zürich: Pendo-Verlag, 2004.
- Bochsler, Regula. Margarethe Hardegger. In : Dictionnaire historique de la Suisse [en ligne]. Version du 21.01.2021
- Boesch, Ina. Gegenleben: die Sozialistin Margarethe Hardegger und ihre politischen Bühnen. Zürich: Chronos-Verlag, 2003.
- Schindler, Patrick. Vie et luttes de Margarethe Faas-Hardegger : anarchiste, syndicaliste & féministe suisse : pour le centenaire de « L'Exploitée », 1907–2007. Paris: Editions du Monde libertaire, 2007.
Sur Else Züblin-Spiller
- Ludi, Regula. Else Züblin-Spiller. In : Dictionnaire historique de la Suisse [en ligne]. Version du 12.04.2021
- Schnyder, Moia. Zwei Pionierinnen der Volksgesundheit: Susanna Orelli-Rinderknecht, 1845–1939; Else Züblin-Spiller, 1881–1948. Wetzikon: AG Buchdruckerei Wetzikon, 1973.
- Parzer-Epp, Verena. Else Züblin-Spiller (1881–1948). In: Pionnières de la Suisse moderne : des femmes qui ont vécu la liberté. Genf: Slatkine, 2014, S. 221–223.
Sur Dora Staudinger
Dernière modification 18.11.2021
Contact
Bibliothèque nationale suisse
SwissInfoDesk
Information au public
Hallwylstrasse 15
3003
Berne
Suisse
Téléphone
+41 58 462 89 35
Fax
+41 58 462 84 08