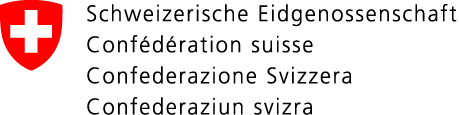Le village d’enfants Pestalozzi voit le jour en 1946 à Trogen (Appenzell). C’est un bel exemple d’établissement très ancien rarement mentionné dans le canon du patrimoine bâti. Pour le jubilé de l’Année européenne du patrimoine architectural en 1975, une plateforme sera consacrée au «patrimoine des minorités, des groupes marginalisés et des personnes sans lobby».
Par Kathrin Gurtner

En 1972, le Conseil de l’Europe lance la campagne «Année européenne du patrimoine architectural 1975». Sous le mot d’ordre «Un avenir pour notre passé», on pose les fondations de la protection du patrimoine bâti et de la sensibilisation de l’opinion publique aux multiples valeurs des bâtiments et sites chargés d’histoire.
Cinquante ans plus tard, dans une société de plus en plus diverse, la question prend une dimension nouvelle : «Un avenir pour le passé de qui ? Le patrimoine des minorités, des groupes marginalisés et des personnes sans lobby.» Ce slogan revisité attire volontairement l’attention sur des constructions qui, jusque-là, étaient à peine considérées par la culture de la mémoire officielle. Il est vrai que les «Principes pour la conservation du patrimoine culturel bâti» de 2007 font déjà de la protection du patrimoine des minorités une responsabilité de la société tout entière, mais dans les inventaires suisses existants, cela ne saute pas aux yeux. Les recherches dans les Archives fédérales des monuments historiques confirment cette impression. Tandis que les églises remarquables, les édifices gouvernementaux et les fouilles archéologiques y sont bien documentés, on trouve en revanche très peu de mentions concernant les foyers pour enfants et les autres lieux d’accueil de «personnes sans lobby». Pourtant, au fil des siècles, ces établissements ont été des éléments importants d’un vaste système d’assistance, et leurs caractéristiques architecturales marquent souvent de manière décisive les enfants concernés.
Les foyers pour enfants, miroirs des convictions sociales

Les premiers foyers pour enfants et orphelinats des XVIIe et XVIIIe siècles sont de grands et prestigieux bâtiments, placés bien en vue dans les villes et les villages. On rencontre des constructions d’un style analogue, semblables à des châteaux baroques, par exemple à Berne, Zurich et Saint-Gall. Elles servent tout autant à «garder» des enfants que des pauvres et des délinquants. Leur conception tient à peine compte des besoins et des proportions des enfants, la finalité étant bien plus d’exhiber la puissance des autorités.

Au cours du XIXe siècle, de plus en plus d’institutions, le plus souvent à vocation caritative ou religieuse, voient le jour : c’est un véritable boom. On préfère désormais les placer à la campagne plutôt qu’en milieu urbain. En plus des orphelinats et des institutions pour pauvres, des «établissements de secours» voient ainsi le jour, dont le but est d’éduquer et de «secourir» des enfants «abandonnés». Lorsque cela s’avère possible, ces établissements s’installent dans des bâtiments existants, comme des fermes ou des couvents, qu’on transforme pour les adapter aux nouveaux besoins. En cas de construction à proprement parler, l’architecture reflète le concept pédagogique, fondé sur la discipline et l’ordre.
De l’institution à l’espace de vie

Au début du XXe siècle, la réforme de la pédagogie apporte de premières évolutions visant à mieux tenir compte de l’enfant dans l’architecture. Les dimensions des bâtiments restent imposantes, mais ils se font plus accueillants. La répartition des espaces, désormais à taille humaine, offre une certaine différenciation : les enfants sont maintenant logés séparément selon leur sexe et leur âge. Souvent, ces établissements sont associés à des exploitations agricoles dans lesquelles les enfants travaillent dur.
Dès les années 1920, les conditions de vie nuisibles qui régnent dans de nombreux établissements pour enfants sont régulièrement critiquées, mais c’est seulement après la Seconde Guerre mondiale qu’un nouvel idéal s’impose. Une institution ne doit plus être seulement un lieu de placement, mais un « foyer » au sens plein du terme, un lieu où les enfants peuvent se sentir chez eux. Les immenses bâtiments anonymes cèdent la place à des constructions plus petites, plus accueillantes. L’organisation des pièces fait la part belle à la lumière, à la couleur et au confort. Les espaces extérieurs réservent une place au jeu.
Le village d’enfants Pestalozzi

Le village d’enfants Pestalozzi, construit à Trogen en 1946 pour les enfants de toute l’Europe traumatisés par la guerre, est un modèle d’architecture adaptée aux enfants. L’architecte, Hans Fischli (1909-1989), s’est inspiré de l’architecture rurale régionale, alors qu’il s’était auparavant fait un nom avec des constructions cubistes de style Bauhaus. Les maisons s’insèrent harmonieusement dans le paysage et créent ainsi une atmosphère de sécurité et de normalité.
Dans les maisons, les enfants et leurs éducateurs, issus des mêmes pays que leurs pupilles, vivent dans un cadre qui rappelle la structure familiale. Loin de représenter un corps étranger, les bâtiments s’intègrent au paysage de l’Appenzell, et Fischli souhaite qu’il en aille de même pour les enfants du monde entier, qui méritent la chaleur et la protection d’un foyer. Le moindre détail est adapté aux besoins et à la taille des enfants, de la disposition des pièces à l’aménagement. Les locaux ne doivent surtout pas rappeler les institutions d’éducation, mais dégager l’atmosphère familière de maisons d’habitation normales. «J’adore mes maisons appenzelloises fraîchement bâties», déclare joyeusement Hans Fischli une fois les travaux terminés. Un enthousiasme qui, aujourd’hui encore, est largement partagé. Que ce soit du point de vue architectural, pédagogique ou social, le projet de Fischli reste un jalon majeur dans la promotion d’une coexistence pacifique.
À partir de 1972, la campagne «Année européenne du patrimoine architectural 1975» a été essentiellement portée par le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS). Son concept a été élaboré sous la houlette du Suisse Alfred A. Schmid (1920-2004), professeur d’histoire de l’art à Fribourg, qui fut longtemps président de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) et membre du comité exécutif de l’ICOMOS.
Ses abondantes archives, ainsi que celles de l’Année européenne du patrimoine, sont conservées aux Archives fédérales des monuments historiques de la Bibliothèque nationale suisse.
Bibliographie et sources
- «A future for whose past? Un avenir pour le passé de qui? Das Erbe von Minderheiten, Randgruppen und Menschen ohne Lobby.» Éditeur : AG Denkmalschutzjahr 2025, ICOMOS Suisse, Denkmalpflege der ETH Zürich, Zurich : Hier und Jetzt Verlag, 2025.
- «Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz», éd. Commission fédérale des monuments historiques, Zurich : vdf Hochschulverlag AG, 2007.
- Chmelik, Peter, «Armenerziehungs- und Rettungsanstalten: Erziehungsheime für reformierte Kinder im 19. Jahrhundert in der deutschsprachigen Schweiz». Reinach : P. Chmelik, 1986 (thèse de doctorat en philosophie, Zurich 1975).
- «Aufwachsen ohne Eltern: Verdingkinder, Heimkinder, Pflegekinder, Windenkinder: zur ausserfamiliären Erziehung in der deutschsprachigen Schweiz.» Éd. Jürg Schoch, Heinrich Tuggener, Daniel Wehrli, Zurich : Chronos-Verlag, 1989.
Dernière modification 29.07.2025
Contact
Bibliothèque nationale suisse
Cabinet des estampes
Hallwylstrasse 15
3003
Berne
Suisse
Téléphone
+41 58 462 89 71