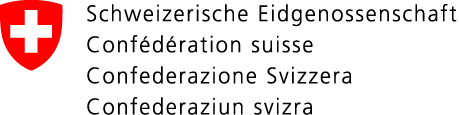Gesammelte Werke (Stuttgart, J.G. Cotta,
1906). Annotiertes Exemplar aus der
Gelehrtenbibliothek von Jonas Fränkel.
Il existe de nombreuses façons d’identifier les sources d’inspiration des grandes œuvres littéraires : on peut recourir aux témoignages directs des écrivains ; repérer les lectures mentionnées dans les carnets ou les correspondances ; analyser les échos et emprunts aux œuvres de tiers dans les textes publiés ; ou encore parcourir la bibliothèque de l’auteur, dans l’état où elle a été conservée.
Cette dernière méthode a les attraits de l’objectivité, de la scientificité : quoi de mieux que d’avoir accès matériellement à ses livres pour comprendre l’univers dans lequel un écrivain a baigné. Mais attention, les livres possédés (et conservés) ne coïncident pas forcément avec les livres lus. Il n’est pas rare que les bibliothèques contiennent ainsi des volumes jamais ouverts (comme les exemplaires non coupés). Les traces de lecture, quant à elles, attestent de l’appropriation matérielle et intellectuelle du livre par son propriétaire : l’écrivain a bien feuilleté cet ouvrage et entamé un dialogue avec son auteur.
Cet échange peut d’ailleurs être plus ou moins soutenu : certaines marques sont involontaires (pages froissées, reliure abîmée) ; elles sont parfois discrètes et silencieuses (croix dans la marge, signets vierges) ; parfois ostensibles et verbales (emploi de couleurs, notes marginales ou sur les pages de garde). On sait alors non seulement que le livre a été lu, mais aussi un peu de ce qui a retenu l’attention du lecteur. Il est possible de rencontrer des notes de provenance et d’érudition, des signets ou des index manuscrits à vocation documentaire, des commentaires personnels voire des traits d’humeur, etc.
Autant d’indices que les chercheurs tentent de faire parler pour mieux comprendre les références intellectuelles qui nourrissent le travail créateur. Les notes marginales, en particulier, ont acquis un statut littéraire et sont devenues un objet d’études à part entière, comme en témoignent par exemple les éditions papier ou numérique des marginalia de Voltaire ou de Thomas Mann.
Les ALS conservent plusieurs bibliothèques d’auteurs, auxquelles des publications ont déjà été consacrées (dont Passim 4, 2009 et Quarto 30/31, 2010). Ce numéro de Passim plonge cette fois au cœur des rayonnages, entre les pages des volumes, à la recherche des traces laissées par leurs détenteurs. Des études de cas révèlent entre autres les pratiques de lecture d’un philosophe (Voltaire), d’un critique (Starobinski) et d’un écrivain (Cendrars).
Passim 35 | 2025 (PDF, 6 MB, 17.06.2025)Bulletin des Schweizerischen Literaturarchivs | Bulletin des Archives littéraires suisses | Bollettino dell’Archivio svizzero di letteratura | Bulletin da l’Archiv svizzer da litteratura
Dernière modification 17.06.2025