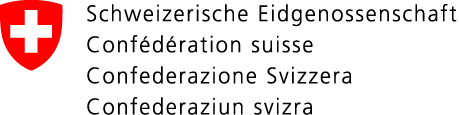Depuis le XIXe siècle, la montagne attire et fait rêver. Avec ses nombreux sommets, la Suisse est un haut lieu de l’alpinisme. Au rang des traditions vivantes du pays, cette pratique a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2019.
L’alpinisme figure en bonne place sur le site web «Les traditions vivantes de la Suisse» de l’Office fédéral de la culture. Comment cette pratique est-elle entrée progressivement dans l’ADN du pays?
Les montagnes n’ont pas toujours exercé la même fascination. Jusqu’à la fin du Moyen Âge, elles étaient considérées comme dangereuses et n’inspiraient rien qui vaille. Beaucoup les croyaient habitées par des démons et d’autres créatures – on ne s’en approchait guère. Ce n’est qu’à l’époque des Lumières, vers la fin du XVIIIe siècle, que des naturalistes ont commencé à les explorer à des fins scientifiques et qu’elles sont apparues sous un nouveau jour.
L’alpinisme consiste à se déplacer hors des sentiers de montagne et à faire face aux dangers de ce milieu naturel, comme les éboulements ou les crevasses. Il diffère en cela de la randonnée sur des itinéraires tracés, ou du ski alpin pratiqué sur des pistes sécurisées. Il requiert un équipement spécialisé – cordes, piolets, crampons – et suppose de maîtriser des techniques d’ascension. Les alpinistes se servent en outre de leur sens de l’orientation et de leur intuition pour choisir les meilleurs itinéraires.
Le Cervin et «l’âge d’or de l’alpinisme»

Lötschental et étudie sa carte (1950).
(Source: ALS-Graber)
© Bibliothèque nationale suisse, Alfred Graber
L’alpinisme est devenu populaire au milieu du XIXe siècle, alors que les Alpes étaient considérées comme le «terrain de jeu de l’Europe». S’est engagée une course folle: c’était à qui gravirait en premier les principaux sommets. Rien qu’entre 1850 et 1865, les alpinistes – parmi lesquels une poignée de femmes – ont conquis une trentaine de sommets suisses de plus de 3000 et 4000 mètres.
Cette phase a atteint son apogée avec la première ascension du Cervin, l’une des plus célèbres de Suisse. Après plusieurs expéditions infructueuses, l’Anglais Edward Whymper et ses compagnons réalisèrent enfin l’impossible en 1865. Mais ils payèrent très cher cet exploit: quatre membres du groupe chutèrent mortellement durant la redescente. Whymper et deux autres hommes survécurent grâce à une rupture de corde. Depuis, le Cervin n’a cessé de prendre des vies. Plus de 500 personnes ont péri en se mesurant à lui. Aucun sommet dans le monde n’est connu pour être aussi mortel.
L’alpinisme au féminin

© Bibliothèque nationale suisse, Alfred Graber
Bien que minoritaires, les femmes ont dès le début participé aux expéditions en haute montagne, mais il n’en reste que peu de traces. Pour nombre de leurs congénères, leur présence représentait une atteinte à l’identité masculine, l’alpinisme étant une «affaire d’hommes». Aussi étaient-elles rarement mentionnées ou photographiées. Même si les statuts du Club alpin suisse (CAS), fondé en 1863, ne limitaient pas l’adhésion aux hommes, les fondateurs considéraient le club avant tout comme une «association masculine». Officiellement exclues du CAS en 1907, les femmes créèrent leur propre association en 1918, le Club suisse des femmes alpinistes (CSFA). Les deux clubs alpins ne fusionnèrent qu’en 1980.
Cet éclairage historique explique pourquoi le Musée alpin suisse manque aujourd’hui de matériau pour documenter l’alpinisme féminin. Afin d’y remédier, il a monté une exposition virtuelle intitulée «Femmes en montagne» dans le cadre de son «Bureau des souvenirs retrouvés» et invité les femmes à partager objets et souvenirs en lien avec l’alpinisme.
Évolution de la fin du XIXe siècle à nos jours
Après avoir connu son âge d’or en Europe, l’alpinisme est entré dans une phase marquée par la conquête de sommets plus lointains et l’intérêt pour des itinéraires plus techniques. À partir des années 1970, ce sport de l’extrême a fait tourner les têtes aux quatre coins du globe.

au bord d’un lac de montagne dans le
Lötschental (1950). (Source: ALS-Graber)
© Bibliothèque nationale suisse, Alfred Graber
Aujourd’hui, le tourisme alpin est en plein essor. L’alpinisme est devenu un sport comme un autre et attire de plus en plus d’amateurs qui, GPS et carte interactive en main, se risquent à partir en montagne sans guide. À l’ère de la technologie, on a tôt fait d’oublier que rien n’a le pouvoir d’écarter les dangers de la montagne.
Bibliographie et sources
- Page «Alpinisme» du site web «Les traditions vivantes en Suisse» de l’Office fédéral de la culture (OFC).
- Meinherz, Paul, Alpinisme. In: Dictionnaire historique de la Suisse, édition en ligne (état: 2008).
- Résultats de recherche pour les publications d’associations du Club alpin suisse (CAS) dans le fonds de la BN.
- L’alpinisme devient «immortel». L’UNESCO élargit la Liste du patrimoine culturel immatériel. In: site web du Club alpin suisse (publié le 11.12.2019).
- Aurel Schmidt. Die Alpen. Eine Schweizer Mentalitätsgeschichte. Frauenfeld: Huber, 2011.
- Tanja Wirz. Gipfelstürmerinnen. Eine Geschlechtergeschichte des Alpinismus in der Schweiz 1840-1940. Baden: Hier + jetzt Verlag für Kultur und Geschichte, 2007.
- Flückiger, Alfred. Alpinismus in der Schweiz = L’alpinisme en Suisse = Moutnaineering in Switzerland. Zürich: Schweizerische Zentrale für Verkehrförderung, 1951.
- Die Suche nach der Wahrheit: 150 Jahre Erstbesteigung Matterhorn vom 14. Juli 1865 = The search for the truth: 150 years since the first ascent of the Matterhorn on 14 July 1865 = La recherche de la vérité : 150 ans depuis la première ascension du Cervin, le 14 juillet 1865. Visp: Rotten-Verlags-AG, 2015.
- Flückiger-Seiler, Roland. Berghotels. Zwischen Alpweide und Gipfelkreuz. Alpiner Tourismus und Hotelbau 1830-1920. Baden: Hier + jetzt Verlag für Kultur und Geschichte, 2015.
- Entwicklung des Alpinismus in Zermatt (1792-1911). In: Walliser Bote, 8 juillet 1994, p. 9.
- Bergsteiger-Ansturm aufs Matterhorn In: Walliser Bote, 27 juillet 2018, p. 2.
- Rapport annuel 2023 (en allemand) du Musée alpin suisse. Exposition «Femmes en montagne»
Dernière modification 30.04.2025
Contact
Bibliothèque nationale suisse
SwissInfoDesk
Utilisation
Hallwylstrasse 15
3003
Berne
Suisse
Téléphone
+41 58 462 89 35