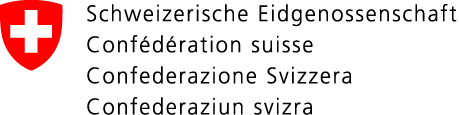25 ans après avoir quitté l’Université de Berne suite à la publication de son essai historique controversé «La Démocratie et la Suisse» (1929), Gonzague de Reynold renoue avec l’alma mater bernoise grâce à son ami et successeur à la chaire de littérature française, Pierre-Olivier Walzer
Par Denis Bussard
La présence à Berne des archives de l’historien et essayiste fribourgeois Gonzague de Reynold, fervent fédéraliste, et du critique littéraire Pierre-Olivier Walzer, sympathisant de la cause jurassienne, n’allait pas forcément de soi. C’est pourtant dans la capitale et particulièrement autour de son alma mater qu’une partie du destin des deux hommes s’est jouée, pour leurs carrières respectives comme pour leurs relations personnelles. Une histoire en plusieurs actes qui n’avait pourtant pas bien commencé …

(Photo: BN, Simon Schmid)
La réinterprétation aristocratique et autoritaire de l’histoire suisse proposée dans «La Démocratie et la Suisse» (1929) par Reynold, alors professeur de littérature à l’Université de Berne depuis 1915, va fortement agiter le monde politique et universitaire bernois. Si certains dénoncent le manque de scientificité de l’ouvrage, la plupart des reproches concernent les thèses défendues par Reynold dans son essai comme dans ses cours. Un Comité d’action, qui diffuse un tout-ménage intitulé «Die Affäre Reynold», l’accuse d’utiliser l’estrade pour propager des idées anti-libérales et anti-démocratiques et de privilégier l’étude d’écrivains ultra-catholiques. Le gouvernement cantonal défend Reynold au nom de la liberté d’opinion et de l’indépendance de l’Université face aux parlementaires qui réclament une enquête. Désirant quitter la capitale dans laquelle il se sent isolé, le comte de Cressier accepte finalement l’appel de l’Université de Fribourg en 1931 pour occuper la chaire d’histoire de la civilisation à l’époque moderne.
Ça sera donc à Fribourg au début des années 1940 que le jeune Walzer, après un séjour à Paris pour faire sa thèse, rencontre Reynold : alors enseignant dans un camp d’internés, il suit parallèlement les cours de l’historien. Imprégéné de culture classique, Walzer avait fréquenté en France un «cercle d’intellectuels catholiques traditionalistes évoluant sur les marges extrêmes de la droite» (Claude Hauser, 1999) et il adhère à la version «catholique-conservatrice» de la Suisse proposée par Reynold : «Si je n’étais pas d’accord avec toutes ses idées, j’ai néanmoins été influencé par lui», reconnaît l’auteur «De quelques héros» (1943), son premier livre «marqué par son ascendant».
Après guerre, Walzer prend ses distances avec l’idéologie véhiculée par l’aristocrate. Professionnellement en revanche, il suit ses traces : une décennie après le départ de Reynold, Walzer enseigne à son tour à Berne (à la Realschule). «Vous voilà donc à Berne où je suis si content de ne plus être que […] j’en remercie Dieu tous les matins. Tâchez de ne pas y perdre votre tempérament comme cela arrive, selon un vétérinaire du Palais, aux chiens et aux chevaux de race dès qu’ils sont là-bas. Tâchez surtout de ne pas y rester», lui recommande Reynold en 1943.
Walzer y fera pourtant toute sa carrière comme professeur de littérature française à l’Université de Berne (1955-1985) et sera même l’artisan de la réconciliation entre Reynold et la capitale. En 1956, l’historien fribourgeois y prononce à l’invitation du nouveau professeur une conférence sur «La Berne française au XVIIIe siècle» : «C’est à vous que je dois […] cette joyeuse rentrée à Berne […]. Merci encore de tout cœur de m’avoir aidé à remplacer un mauvais souvenir par un bon. C’est une date dans mon existence», confie Reynold à Walzer trois jours plus tard.
Si Reynold passe rapidement dans ses «Mémoires» sur ce qu’il nomme «la grande tempête», Walzer s’en fera l’un des premiers historiographes : en 1980, il rassemble une documentation conservée aux ALS et retrace, de manière quelque peu partiale, l’ «Affaire Reynold» dans le Journal de Genève. Réactivant la traditionnelle opposition entre «mémoire» et «histoire», Walzer prendra jusque dans les années 1990 le parti de son ancien professeur et ami, en défendant surtout l’écrivain et l’homme qu’il a connu, selon lui volontiers provocateur et ironique, face à ce qu’il considère comme la «science froide» des nouveaux historiens, qui ont depuis démontré l’influence de cet «idéologue d’une Suisse autoritaire» (Aram Mattioli, 1997) sur les mouvements réactionnaires de la première moitié du XXe siècle.
Les inventaires des archives du professeur et éditeur Pierre-Olivier Walzer (1915-2000) et de l’historien et essayiste Gonzague de Reynold (1880-1970) sont disponibles en ligne sur HelveticArchives depuis cet été. Ces inventaires complètent, en fournissant de nombreux détails, les catalogues papier qui existaient pour ces riches fonds remis en 1956 (Reynold) et en 1991 (Walzer) à la Bibliothèque nationale suisse.
Dernière modification 08.09.2025